La Pontiac Grand Prix de 1972, jadis de couleur verte, est devenue marron. Abandonnée sur les pentes du mont Saint Helens, dans l’Etat de Washington, l’épave mangée par la rouille et envahie par la végétation sert de mémorial aux victimes Donald et Natalie Parker, un couple de mineurs morts le 18 mai 1980 dans l’une des éruptions volcaniques les plus dévastatrices de l’ère moderne. C’est l’un des quatre sites où Olivier Bodart a choisi de situer l’intrigue de son roman.
Une nuée ardente dans le Nord-Ouest, un glissement de terrain en Californie, un effondrement du sous-sol en Floride : autant de désastres qui requièrent l’attention de Mat, enquêteur de la FEMA, l’agence américaine en charge des situations d’urgence. Mais voilà, le personnage principal du roman est incapable de quitter son « centre » : Lebanon, Kansas, mitan géographique des Etats-Unis. Pour produire ses rapports, il construit la maquette de chaque site chez lui, en miniature – l’un des nombreux allers-retours entre le champ de la fiction et celui du réel dans le roman d’Olivier Bodart.
France-Amérique : Comment avez-vous découvert la FEMA ?
Olivier Bodart : Une semaine avant l’ouragan Katrina [en août 2005], j’étais en Louisiane, je voyageais entre La Nouvelle-Orléans et le sud du Mississippi sur les traces de l’écrivain américain Larry Brown. Peu de temps après mon retour en France, Katrina dévaste la région et je découvre la FEMA. On a beaucoup parlé de cet organisme gouvernemental à cette époque, pour de bonnes et de mauvaises raisons : on pense à tous ces gens parqués dans le stade de football de La Nouvelle-Orléans. En faisant des recherches, j’ai appris que la FEMA était à l’origine spécialisée dans l’élément aquatique avant de s’étendre à toutes les catastrophes naturelles. Mon livre passe en revue les quatre éléments : l’eau, la terre, le feu et l’air.
Vous semblez fasciné par les catastrophes naturelles…
Elles ont quelque chose de terrifiant et en même temps d’extrêmement beau. J’ai toujours été sensible au pouls de la planète et attiré par la géographie américaine, l’étendue du territoire, sa météorologie, sa littérature, ses histoires…
Le personnage de Mat est « tétanisé » par l’existence. Vous-même avez traversé « une période de désarroi » pendant l’écriture de ce roman. Le parallèle est-il fortuit ?
Je m’apprêtais à finir le livre lorsque j’ai perdu toute foi en la fiction. Je ne croyais plus aux histoires que je lisais ou que j’essayais moi-même de raconter. Au moment de cette perte de goût, je vivais aux Etats-Unis depuis trois ans. Embauché par le Lycée Français de Chicago pour diriger le département des arts et enseigner les arts visuels, je suis arrivé en famille en 2012. Mais mon couple n’a pas résisté à l’expatriation et ma fille est partie vivre avec mon ex-épouse à Washington D.C. Le désarroi vient de là, d’un choc familial, d’un éloignement géographique et émotionnel. C’est l’un des thèmes du roman. Qu’est-ce que la distance ? De quelle manière s’impliquer ou ne pas s’impliquer ? Mat décide de rester dans son centre. Il préfère recréer la réalité plutôt que de la vivre.
Sur ce point, votre histoire personnelle diffère de celle de Mat…
Plutôt que de rester pétrifié, j’ai décidé de bouger. J’ai eu le projet absurde d’aller visiter le site des quatre catastrophes que j’évoque dans mon roman : Meta Lake dans l’Etat de Washington, Ben Lomond en Californie, Seffner en Floride et Lebanon au Kansas. Je voulais que mon livre ait un impact sur ma vie, via mes voyages et rencontres. J’ai ensuite intercalé dans le roman le récit de mon expérience sur place. J’ai aussi décidé de produire en vrai ces boîtes vitrines que Mat réalise, à l’aide de matériaux naturels que j’ai trouvé sur place.


Qu’avez-vous découvert sur chaque site ? Racontez-nous votre expérience sur le terrain…
Il n’y a plus grand-chose à voir sur place, puisque les désastres ont eu lieu il y a des années, voire des décennies. Dans cette banlieue de Floride, où un trou s’est ouvert en 2013 sous le lit d’un homme en train de dormir, les autorités ont détruit la maison. On ne sait pas ce qu’il se passe sous le sol, le terrain est condamné. Je voulais éprouver les traces, les stigmates de la terre, ce qu’il reste de la catastrophe – dans ce cas, un rond de gazon qui n’a pas la même couleur que le reste de la parcelle. Dans le cas de l’explosion volcanique du mont Saint Helens, j’ai découvert lors de ma seconde visite cette voiture calcinée : c’est là que le lien émotionnel s’est fait. Ces lieux ne sont pas spectaculaires – ce n’est pas les chutes du Niagara ! – mais ils sont chargés d’émotions.
Avez-vous retrouvé votre appétit pour la fiction ?
Je l’ai retrouvé en partie. Je sais que mon goût pour la fiction ne fonctionnera plus que s’il est combiné à du réel. Le roman que j’écris maintenant, sur le désert de Sonora en Californie, explore ce rapport entre fiction et réalité. Je termine Zones à risques sur cette rencontre avec Christian Boltanski, de passage à Chicago, qui déclare : « Vous n’irez jamais sur les traces d’une œuvre complètement inventée. »
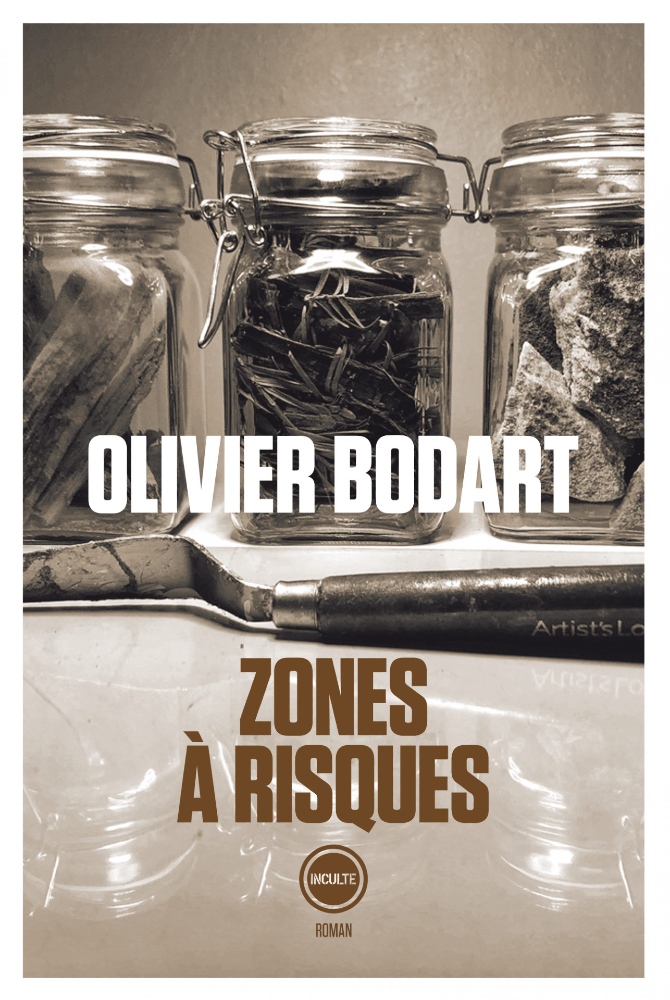
Zones à risques d’Olivier Bodart, Editions Inculte, 2021. 420 pages, 21,90 euros.






















